Réflexions autour de l’étude publiée par la HAS.
La Haute Autorité de Santé (HAS) vient de publier une très intéressante étude de Claire Compagnon et Véronique Ghadi sur « la « maltraitance ordinaire » dans les établissements de santé ». (Le rapport et les documents associés : consultables et téléchargeables à partir de cette page du site de la HAS).
Une étude à lire. Importante.
Précautions
Mais avant d’en parler sans doute est-il nécessaire de s’arrêter quelques minutes sur deux arguments récemment entendus, censés justifier pour certains qu’on ne prête pas attention à cette étude :
- Un argument qu’on pourrait qualifier de politique. Constat est fait que l’étude ne porte que sur les établissements publics, qu’elle arrive dans un contexte socio-politique particulier, dans un pays où l’opinion apprécie majoritairement les professionnels de la santé et le système public de santé, tout cela au moment même où se système est menacé.
Bref, certains se demandent si c’est bien un hasard qu’une telle étude paraisse maintenant : voudrait-on fâcher les Français avec leurs soignants pour mieux les rendre indifférents à cette menace ?
D’autres trouvent qu’il est pervers de publier des études sur la « maltraitance des hôpitaux » alors même que lesdits hôpitaux font ce qu’ils peuvent pour supporter les assauts cumulés de la précarisation de certains de leurs salariés, d’impératifs de rentabilité (imposés à des pratiques qui ne peuvent l’être), de modes de tarification ou de gestion inadaptés à leurs missions, etc. - Autre argument, comme à chaque fois, dans quelque domaine que ce soit, que l’on travaille davantage sur ce qui dysfonctionne que sur ce qui fonctionne bien : crainte qu’une telle étude conduise à des amalgames (« tous les soignants sont maltraitants ») et à une méfiance généralisée. Il est donc important de rappeler, et d’autant plus important de le faire que les témoignages citées dans cet étude poussent à la révolte, que de très nombreux soignants, quotidiennement, et ce malgré les contraintes psychiques, matérielles et économiques souvent très lourdes qu’ils subissent, parviennent à ne pas en reporter le poids sur les personnes dont ils prennent soin, parviennent à rester dans la relation et dans l’attention à l’autre souffrant ou inquiet.
Bref, ces méfiances et ces craintes sont justes : elles doivent en effet nous inciter à lire cette étude avec nuances et à ne pas en tirer de fausses conclusions.
Mais certainement pas aboutir à nous en désintéresser !
Ordinaire ?
Une étude précieuse, donc. D’autant plus précieuse qu’elle n’a pas cherché à enfermer son sujet dans un regard quantitatif, dans des chiffres, tableaux, cases… Qualitatif, narratif, subjectif, impressionniste, ce travail revendique ces dimensions. Avouons-le : quel plaisir dans nos sciences humaines envahies d’obsessions statistiques et scientistes que soit simplement et clairement assumé qu’on ne peut cerner avec des grilles et des courbes une grande partie de ce qui est en jeu dans les relations de prendre-soin !
Des entretiens, des témoignages, des lettres, des paroles qui justement débanalisent et rendent visibles certaines de ces formes insidieuses de violence regroupées sous ce terme de « maltraitance ordinaire » (d’autres disent « maltraitance passive » ou « maltraitance institutionnelle »).
La précision est essentielle : il s’agit bien ici de ces maltraitances quotidiennes et bien souvent involontaires, loin de celles, exceptionnelles, crimes ou délits commis intentionnellement et pour lesquels, quel que soit le lieu de vie de la victime (hôpital ou domicile), quelle que soit la situation du coupable (chef de service, aide-soignante, voisin, membre de la famille, inconnu…), il existe un traitement précis : celui que décrit le code de procédure pénale.
Donc, ici, ni délits ni crimes. Ici, bien souvent, pas d’intention de nuire. Ici, bien souvent, pas de conscience des conséquences du comportement ou de l’absence de comportement. Ici, bien souvent, on va le voir, dominent justement l’absence de conscience, l’absence de pensée, d’intention, d’empathie. Au bout de toutes ces absences, l’absence de l’Autre.
« Coralie, ma fille, est restée nue sur le brancard, dans le couloir du service pendant 10 minutes. J’ai pris alors une couverture dans la chambre, et on m’a reproché d’avoir défait le lit ! » (Parents d’enfant hospitalisé)
Ce pour quoi, j’y reviendrai, cette maltraitance « ordinaire » peut avoir des conséquences aussi toxiques que des formes plus visibles, plus spectaculaires, plus physiques, de violences. Un individu qui volontairement obligerait quelqu’un à se faire pipi dessus, un individu qui volontairement enfermerait quelqu’un et le priverait de nourriture, un individu qui volontairement séparerait une mère de son bébé, etc., autant de situations qui nous feraient percevoir un tel individu comme un tortionnaire…
Mais des patients contraints à se faire pipi dessus parce que personne ne répond à leurs appels pour les accompagner aux toilettes, des patients qui ne peuvent manger seuls et qui restent, des heures durant, devant une assiette inatteignable, des mères qui ne peuvent accompagner leurs enfants lors de soins difficiles, voire lors de leurs derniers jours ou dernières heures de vie… Des patients subissant tout cela, c’est chaque semaine dans les hôpitaux de France et d’ailleurs.
Et ce ne sont pas des tortionnaires qui permettent cela : ce sont des professionnels comme vous ou moi (et j’insiste sur ce « vous ou moi », car nul ne peut prétendre avec certitude être à l’abri, dans certaines situations, dans certains contextes professionnels ou sociaux, de cette banalisation de la violence), ce sont des organisations sans âme ni conscience, ce sont des rigidités et des habitudes devenues plus puissantes que les individus qui les subissent et les appliquent, ce sont des relations sans relation, des esprits sans pensée.
Mais revenons donc à l’étude et à l’aspect « ordinaire » des violences qui y sont rapportées. Au-delà des multiples formes de cette violence, c’est bien son « ordinarité » qui interroge, la banalisation, l’invisibilité de ces atteintes à l’autre fragile, faible, en proie à la souffrance, à la peur, à la fin de son indépendance, à l’exposition, à la mise à nu. Invisible : on ne la voit plus, on ne l’entend plus. Cécité, surdité de l’esprit – comme des sens dans ces situations évoquées où ce sont des lumières (violentes), des bruits, sons ou musiques (forts, brutaux, imposés), qui réveillent, qui surprennent, qui choquent sans que ceux qui travaillent et sont éveillés s’en émeuvent.
« Elle voulait me faire faire pipi dans un pistolet d’homme, vous imaginez si c’est facile… Alors elle m’a engueulée parce que j’avais fait pipi et que ça avait débordé à côté. En plus, j’avais eu mes règles, ce n’était pas prévu, alors comme il y avait aussi du sang sur le drap, elle a dit : « Regardez comme elle est dégueulasse ! » Ça m’a choquée. »
Deux compléments
Avant d’entrer dans le vif de l’étude, évoquer deux compléments à sa lecture :
- Les auteures de l’étude indiquent dès le préambule qu’elles n’ont recueillies que peu de témoignages de personnes âgées, de personnes handicapées : « Les entretiens ont été recueillis auprès de personnes ayant à un moment ou à un autre manifesté la volonté – et la capacité – de restituer, expliquer, leur expérience d’usagers des établissements de santé. »
Il sera donc important de compléter un tel travail par une démarche plus active de recueil de témoignages de personnes n’ayant pu manifester aisément cette volonté, par des entretiens menées aussi avec des personnes ayant précisément des difficultés à s’exprimer… Car (beaucoup des professionnels interrogés dans l’étude le soulignent) les services de longs séjours, de gériatrie, figurent parmi ceux où les risques de maltraitance sont les plus importants (personnes très fragiles, très souvent incapables de se défendre…). Or, les trois témoignages provenant de services de long séjour le sont de proches, pas des personnes qui y vivent. Toutes, pourtant, ne sont pas dans l’impossibilité de s’exprimer… - Second complément : l’étude, parce que ce n’est pas son objet, n’évoque qu’en passant la notion de « vulnérabilité » : « […] Pour les usagers des établissements de santé, la situation d’hospitalisation est d’emblée vécue comme une situation de vulnérabilité. »
- Cette affirmation ne suffit pas pour nous aider à penser à ce qu’est la vulnérabilité (qui pose justement la question de l’hypersensibilité normale, légitime, de la personne fragile, à son entourage et à son environnement). Or une partie des actions à mener pour sensibiliser les personnes qui prennent soin à ces « maltraitances ordinaires » passe par un travail de réflexion et de compréhension de cette vulnérabilité, de ce qui fait que, dans certaines situations, à cause de la fragilité, de la blessure, de la peur, de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse, pour soi ou pour un proche, nous sommes naturellement et légitimement plus sensibles à certaines formes, sensorielles, de stimulations, à certaines formes, relationnelles, d’inattentions, d’abus, à certaines formes, psychiques, d’absence de considération, d’empathie, d’explication…
Il est également important de rappeler que l’hypersensibilité qui accompagne la vulnérabilité est normale, qu’elle n’est pas de la « sensiblerie » ou du « caprice »… Encore récemment, au sujet de cette « maltraitance dans les établissements de santé » dont parlait le Médiateur de la République, certains (un élan charitable me fait taire leur nom) ont allégrement reporté sur la victime, sur le patient, la cause du problème : c’est parce qu’il serait « trop sensible » ou en proie au « désarroi » qu’il ressentirait les comportements des professionnels comme des « atteintes à sa dignité »… Erreur de raisonnement. Dangereuse et violente. Qui conduit à nier la spécificité, en termes de fragilité et de vulnérabilité, de celle, de celui, dont on prend soin.
Bref, la lecture de cette étude peut donc être éclairée par toutes celles qui interrogent la notion de « vulnérabilité » et réfléchissent à la nature des relations de prendre-soin (quelques pistes de lecture dans cet article sur la bientraitance).
Quelques aspects de cette « maltraitance ordinaire »
Mais revenons à l’étude elle-même. Nous ne passerons pas en revue tous les apports qu’elle contient. Le mieux est de la lire… Simplement quelques aspects importants, quelques réflexions au fil de la lecture, et quelques témoignages issues de l’étude ou rapportées par le Médiateur de la République (dans le récent numéro de Médiateur Actualités consacré à cette question).
Handicapé depuis la naissance, Monsieur F. décède dans une clinique après la prise en charge tardive d’une occlusion intestinale. Face à ses douleurs intenses, sa mère n’aura de cesse d’alerter l’équipe médicale. Aucune de ses remarques ne sera prise en compte. Les seules paroles entendues par cette dame seront :
« – Votre fils coûte déjà bien assez cher à la Sécurité sociale, et ceci depuis sa naissance… »
« – De toute façon, il est condamné… »
L’étude distingue la maltraitance liée aux comportements individuels et la maltraitance liée à des facteurs institutionnels. La première témoigne surtout des phénomènes suivants :
Des comportements qui surprennent, choquent, blessent (manière d’entrer dans les chambres sans frapper ; manière de ne pas se présenter, ni dire ce qu’on vient faire ; manière de se comporter en présence de la personne malade comme si elle n’était pas là) ; une absence d’écoute de la parole de la personne malade – voire cette parole niée, minimisée, moquée, et particulièrement quand la personne malade parle de sa douleur (l’étude évoque de nombreux témoignages de douleurs non traitées car pas jugées douloureuses… par le soignant), de ses sensations, de ses médicaments, etc.
Des patients ou des proches engueulés, voire menacés de représailles quand ils questionnent, quand ils réclament, quand ils s’inquiètent de choses que le professionnel n’estime pas, lui, sources d’intérêt.
Absence de « Je comprends… », absence d’explications, de partage même des difficultés et des contraintes (et l’on sait pourtant à quel point l’on vit différemment une contrainte imposée sans explication – « est-elle due à ce qu’on m’en veut, qu’on me trouve une sale gueule, que j’ai quelque chose de grave qu’on ne me dit pas, qu’ils ne savent pas ce qu’ils font… ? » – et une contrainte accompagnée d’une explication, ayant du sens).
Sentiment que personne n’est responsable de quoi que ce soit. Il faut dire, pour l’avoir parfois vu, que règne une telle ambiance aussi dans certains services, une telle violence non dite entre tout le monde, un tel poids de tout, depuis les contraintes matérielles jusqu’aux souffrance psychiques et physiques, que toute parole semble devenir impossible. Qu’exprimer un « Je suis désolé » ou un « Vous avez raison, il faut qu’on essaye autrement… » est impensable, indicible, serait vécu comme un écrasement – poids sur soi soudain de toute la misère du monde. Alors, responsable de rien. D’où les « C’est pas ma faute », les « Si vous n’êtes pas content… »
Déresponsabilisation ordinaire, elle aussi, banalisée, comme si le fait de n’être en effet pas responsable de beaucoup de choses (de d’autant moins de choses qu’on nous laisse professionnellement peu d’autonomie, de marge de souplesse et d’ajustement), conduisait à se déresponsabiliser de tout, y compris de ce dont on est pourtant bien responsable. Plus de responsabilité, plus d’autonomie. L’absence de pensée s’approche.
« Il est pénible d’être renvoyée des uns aux autres pour l’obtention d’informations basiques. Les non-médecins renvoient toujours au prescripteur et le prescripteur à l’intendance. On pourrait compter les fois où sur un même sujet le médecin dit « voyez avec tel autre médecin » ou « avec les infirmières » ; les infirmières « il faut voir cela avec le médecin » ou « essayez plutôt de demander aux aides-soignantes ». Et les aides-soignantes : « Voyez avec le médecin », « avec les infirmières ». » (Fille de personne âgée hospitalisée)
L’information
L’un des mérites de cette étude est de révéler le décalage important qui existe, sur cette question de la parole et de l’information, entre le vécu des professionnels interrogés et celui des patients et de leurs proches.
En effet, on y reviendra, la très grande majorité des professionnels font sur ce sujet de la maltraitance « ordinaire » les mêmes constats que les patients et pointent à peu près les mêmes problèmes. Sauf sur quelques aspects, notamment sur celui de l’information : les professionnels n’ont pas le sentiment qu’ils n’expliquent pas assez, qu’ils n’écoutent pas assez, etc.
C’est pourtant bien l’une des carences dont on souffre le plus en établissement de santé : ne pas savoir qui, quand, comment, ne pas savoir pourquoi surtout, être donc en permanence dans l’inquiétude, dans le doute, dans l’incertitude sur la validité, sur le sens, d’un soin, d’une pratique, d’un délai…
En situation de quémander les informations, en risque permanent de se retrouver avec toutes les hypothèses qui naissent quand on ne les obtient pas (« Pourquoi ne me donne-t-il pas ces informations que je demande ? Parce qu’il les ignore, mais comment avoir confiance en ce soignant s’il ignore cela ? Parce qu’il refuse de me les dire ? C’est donc si grave… Parce qu’il a peur ? De quoi… »).
Quel héritage traîne donc encore dans certains établissements, dans certaines institutions, cet héritage où il allait de soi que la confiance est a priori accordée au soignant, que celui-ci a a priori raison, qu’il sait et n’a pas à expliquer, à justifier, à mériter la confiance…
Le questionnement de la personne malade, sa demande d’explication (et ne parlons même pas de sa demande d’un second avis), sont pour certains soignants vécus d’emblée comme violents, quasi insultants. Et reste incompréhensible pour ces soignants-là que le patient qui n’obtient pas une information claire sur ce qu’on lui fait subir puisse être légitimement dans le doute sur la compétence des professionnels qui le soignent. Le patient (ou le proche) qui doute est forcément, pour ces soignants-là, « perturbateur », « méfiant », « paranoïaque », « difficile », « pénible » [cf. note 1].
Et pourtant… Et pourtant, la personne malade (ou le proche) considérée par ces soignants-là comme « pénible », « difficile », « perturbateur », « paranoïaque », est simplement celle qui ne s’est pas soumise, qui ne s’est pas résignée, qui défend son droit à l’information, au respect, etc.
(Ce qui ne signifie pas, bien entendu, que les râleurs, idiots, brutaux, que l’on croise ici et là quotidiennement dans le pays, ne le sont plus à l’hôpital ! Les râleurs-idiots-brutaux sont statistiquement aussi malades que les autres, et aussi présents à l’hôpital que dans tous les autres endroits. Il ne s’agit ici pas de ceux-là… mais bien de ceux qui sont perçus, étiquetés comme tels par certains soignants. Il est, soit dit en passant, important de distinguer les deux, ne serait-ce que pour aider et soutenir les professionnels confrontés aux vrais râleurs-idiots-brutaux et aider et soutenir les faux râleurs-idiots-brutaux face aux professionnels qui les désignent ainsi… !)
Reprenons le fil : au sujet de cette personne malade qui défend ses droits. Il faut pour cela une certaine force. Du courage. Le courage d’affronter de possibles représailles, le courage d’affronter les conséquences que nos exigences légitimes peuvent avoir sur les soins qui nous sont nécessaires. De la force, du courage, d’autant plus difficiles à mobiliser qu’on est fragile, malade, handicapé. Alors la plupart d’entre nous se soumettent. Y compris en le sachant (je rencontre régulièrement des soignants me racontant que, devenus patients le temps d’une hospitalisation, ils n’ont même pas osé demander gentiment à leurs soignants ce qu’ils exigent d’eux-mêmes et de leurs collègues là où ils travaillent. Par faiblesse, par peur, par épuisement…). Hospitalisation rime alors avec soumission, avec humiliation.
Rappel du « message aux soignants » que Marie-Françoise Collière, dont les travaux et livres ont été et restent des apports indispensables à la réflexion sur le prendre-soin, a tenu à transmettre juste avant sa mort, en janvier 2005, tandis qu’elle était hospitalisée :
« Sachez que j’ai pu, par mon expérience de vie me conduisant jusqu’à la mort, constater qu’il suffit d’une rupture comportementale ou gestuelle dans la continuité des soins, pour que toute la qualité du travail d’une équipe soit détruite. Il suffit d’un “mouton noir” pour que la fragilité de celui qui quitte la vie soit confrontée au désarroi, voire au désespoir le plus abrupt.
Les meilleures compétences techniques professionnelles sont annulées par la rupture du respect interpersonnel et prive la personne soignée de parole pour se défendre, car apparaissent alors les réalités des représailles et de la persécution dans les soins.
À chacun, je demande de se centrer sur les forces de vie, sur la mobilisation des ressources vitales, dans le respect de l’individu et de l’humanité, pour promouvoir les soins et promouvoir la vie. »
Les interactions délétères
Grosso modo, on retrouve dans cette étude tout ce que, dans le domaine du prendre-soin gérontologique (et notamment du prendre-soin des personnes atteintes de syndromes démentiels), Tom Kitwood avait répertorié et analysé sous l’expression de Malignant social psychology, à savoir toutes ces interactions délétères, toxiques, qui agissent sur la personnalité, sur le bien-être, sur la sécurité affective, comme des poisons (T. Kitwood en avait pointé 18 : Tricheries, mensonges, chantages ; Désautonomisation ; Infantilisation ; Intimidation ; Étiquetage ; Stigmatisation, rejet et mise à l’écart ; Désynchronisation ; Invalidation ; Bannissement ; Réification ; Indifférence ; Imposition ; Inattention & refus ; Accusations & reproches ; Interruption brutale ; Moqueries, dépréciation ; Mises en échec et demandes impossibles ; Brimades et interruption de parole, d’activité non négociée). Des interactions délétères qui, rappelons-le, n’auront pas les mêmes incidences selon le degré de vulnérabilité de la personne malade, n’auront pas les mêmes conséquences selon qu’elle passe quelques jours hospitalisée… ou qu’elle vit de nombreuses semaines ou années dans l’établissement.
(Précisons, mais cela fera l’objet d’un autre article, que T. Kitwood a analysé également les formes d’interactions positives propres à nourrir la confiance en soi, l’estime de soi et le respect de soi, de la personne vulnérable).
A ces interactions délétères s’ajoutant toutes les formes d’atteintes à la pudeur, à l’intimité, à la confidentialité, etc.
« J’ai eu le chirurgien qui est entré dans ma chambre, j’étais aux toilettes. Je lui ai demandé : « Pouvez-vous sortir ? Cela me gêne. » « Non, moi ça ne me gêne pas ». Il m’a fait ça à deux reprises. » (Victime d’une infection nosocomiale)
Point commun à quasiment tous ces témoignages : l’indifférence à l’autre, l’inattention à l’autre, l’absence d’empathie (d’imaginer ce que l’autre ressent, les conséquences sur l’autre de nos paroles, de nos gestes…). Une absence d’empathie qui va au-delà de l’incapacité à comprendre ce que peut ressentir la personne fragile. Qui va jusqu’à ne même pas penser à ce que l’on ressentirait soi si quelqu’un nous faisait la même chose.
(Par « empathie », je parle bien ici de cette faculté intellectuelle permettant à notre esprit d’utiliser ses connaissances, son imagination et sa sensibilité pour mieux comprendre comment l’autre peut ressentir ce qu’il vit, ce qu’il entend, etc. – Il ne s’agit donc pas de la « contagion émotionnelle », parfois également appelée « empathie »)
Une absence d’empathie qui est à l’origine du comportement : du geste brutal, de la parole blessante, de l’absence d’un regard ou d’un « bonjour ». Une absence d’empathie qui est ensuite à l’origine de l’escalade de l’incompréhension, voire de celle de la violence.
Car faute d’empathie, faute de compréhension, la réaction de la personne victime (plainte, cri, grimace, geste…), au lieu d’être vécue comme légitime (conséquence logique de la brutalité…), est alors souvent perçue comme une forme de violence et d’agressivité. Face à cette agressivité, tout un répertoire de formes de défense se déploie, depuis la négation de ce que ressent l’autre – « Oh, j’ai pas pu vous faire bien mal » ; « vous êtes bien douillet » ; « c’est un caprice, ça » – jusqu’à l’ordre de se taire éventuellement accompagné de menaces.
De nombreux échanges entre professionnels et usagers témoignent de ce cercle vicieux qui fait que la réaction de l’usager est perçue comme violente, agressive, faute de la moindre conscience, du moindre questionnement sur la possible violence de ce qui a précédé. Une « agressivité de l’usager » que le professionnel vivra d’autant plus mal qu’il travaille dans une organisation où lui même peut subir quotidiennement de multiples agressions professionnelles.

Maltraitance organisationnelle.
« C’était une grosse institution où l’humain disparaît, on devient juste une matière première. (…) D’emblée, vous devenez débiteur du médecin, vous lui devez la vie de votre enfant. Ce n’est plus de la dépendance, c’est de la soumission. » (Personne hospitalisée)
L’étude distingue les maltraitances liées à des comportements individuels et celles liées à des facteurs institutionnels. Et souligne que la frontière est mince. Les secondes peuvent conduire aux premières comme les premières, souvent, sont finalement bien apaisées que les secondes les couvrent. Mais la distinction est cependant importante. Nombre de professionnels subissent en effet le poids d’organisations rigides et mécanistes, le poids d’habitudes figées, de vieux horaires, de règles arbitraires, inexplicables et inexpliquées (et les patients qui demandent une explication se voient en général d’autant plus facilement rabroués que le professionnel auquel la question est posée s’aperçoit alors qu’il ne la connaît pas non plus… Tellement plus facile, quand on suit sans autonomie une règle depuis des années, de (se) faire croire qu’on est autonome en jouant de son pouvoir et en répondant « C’est comme ça ici ! » – Qui, parmi nous, dans sa vie professionnelle ou privée, oserait jurer de n’avoir jamais répondu « n’importe quoi » en pareil constat soudain d’absence de sens…).
On regrette que l’étude n’ait pas en revanche tenté de faire également quelques distinctions, dans toutes les situations rapportées, entre celles qui témoignent de soignants épuisés, débordés, sous pression, manquant de moyens et de connaissances, mais ne prenant pas plaisir à faire ce qu’ils font et à en constater les conséquences – et celles qui nous montrent des professionnels qui, de toute évidence, ont besoin de, prennent plaisir à, en vrac, dominer, humilier, faire souffrir, écraser, user et abuser de leur force et de leur pouvoir.
Il existe bien parmi les professionnels de la santé des personnes qui, comme on en croise dans toutes les autres professions, sont méchantes, sadiques, perverses.
Quand assumera-t-on clairement que ces personnes-là n’ont pas à travailler dans des établissements où passent, où vivent, des personnes fragiles, malades, handicapées ?
Mais revenons à la « maltraitance organisationnelle »
Les constats des patients et des professionnels se rejoignent particulièrement souvent sur ces aspects :
Une dépendance à l’autorité, à l’organisation elle-même, dont souffrent les uns « comme » les autres (méfions-nous en effet de ce « comme » qui risque de conduire une fois de plus à nier la particulière vulnérabilité des personnes malades – Il est à ce sujet toujours étonnant, émouvant souvent, inquiétant parfois, d’assister à ces scènes où ce sont de très vieilles personnes malades, vulnérables, handicapées, qui dans certaines situations – mêlant douleurs, réveil brutal avant l’aube et deux heures d’attente avant un petit-déjeuner pas très bon, consolent les soignants des contraintes professionnelles qu’ils subissent…).
Au patient de s’adapter, jamais l’inverse ; autocensure inculquée dès l’arrivée – il faudrait plus de pages, plus de dialogues, plus de descriptions pour rendre ces centaines de petits signes par lesquels une institution (qu’elle soit hôpital, pensionnat, couvent ou caserne…) fait comprendre implicitement à celui qui débarque quelles sont les limites, les règles, les demandes à ne pas faire, les questions à ne pas poser, les habitudes à perdre, les exigences à abandonner…
Règles implicites, justement, non dites, non affichées, non justifiées : c’est bien un univers kafkaïen qui est parfois décrit, un univers où, bien souvent, personne n’est capable d’expliquer pourquoi telle habitude, tel horaire, telle règle, est appliquée, imposée. Un règlement qui doit bien avoir du sens – mais qui le dit ? Une loi qui doit bien être commune à tous – mais qui la connaît ? Bref, des règles, des normes, mais aussi des horaires, des rythmes, des habitudes, etc. : chacune d’entre elles, chacun d’entre eux est susceptible d’être légitimement ressenti(e) comme arbitraire car ne pouvant être expliqué(e). « Pourquoi ? » « C’est comme ça. »
« Pourquoi ? » « Ici, il n’y a pas de pourquoi. [2] »
Autre aspect : un rapport au temps particulier – où les personnes malades, même quand elles vivent longtemps dans l’institution, ont le sentiment de devoir être vingt-quatre heures sur vingt-quatre à la disposition des professionnels. Des réveils avant l’aube pour des soins qui pouvaient tout à fait attendre…, à l’inverse des attentes interminables sans aucune explication. A chaque fois, il faut le redire, ce n’est pas tant le réveil lui-même ou l’attente elle-même dont souffrent le plus la personne malade, c’est l’absence d’information, d’explication, d’un geste, d’un sourire, d’un seul élément qui lui permettrait de sentir qu’on est attentif à ce qu’elle ressent et qu’on tient compte de son besoin, humain, si humain, de comprendre.
« La réification des patients par le personnel est très profonde. Par exemple, la continuation imperturbable des discussions privées pendant la manipulation douloureuse d’un patient comme s’il n’existait ni lui ni sa douleur est une image qui me suivra. » (Personne hospitalisée)
L’offense faite au sujet.
La question du temps est centrale. Et révèle bien le décalage entre le vécu des professionnels et le vécu des personnes malades.
Car si tous s’accordent à reconnaître les conséquences néfastes du manque de temps et de la nécessité d’aller vite, la majorité des personnes malades ne se plaignent pas de la rapidité du soin, ou du fait que dans le temps imparti au soin le soignant n’a pas eu le temps de faire telle ou telle chose – non, la majorité des personnes malades parlent de disponibilité, de présence et d’attention. Là où les professionnels disent souvent qu’il faudrait que le temps passé avec le patient soit plus long pour pouvoir « être dans le relationnel », les personnes malades disent surtout qu’il n’y en pas eu, de « relationnel », même dans le temps court du soin.
Présence, disponibilité. C’est bien à chaque fois la question de l’attention à l’autre qui revient.
Les professionnels n’ont pas actuellement, dans la presque totalité des hôpitaux (et EHPAD), les moyens et le temps nécessaires pour pouvoir accomplir des soins permettant de travailler au mieux de l’autonomie des personnes, pour pouvoir faire de la prévention, pouvoir remplir toutes les dimensions du prendre-soin, etc.
La très grande majorité des professionnels sont sous-pression, et pressés. Mais. Mais vous avez des médecins pressés qui passent huit minutes avec la personne malade entre deux portes, en pensant à leur voiture, et en matant leurs chaussures, et vous en avez d’autres qui, durant ces huit minutes, la regardent, l’écoutent, bref, lui prêtent attention. Mais vous avez des aides-soignantes pressées qui n’ont pas le temps durant les vingt minutes imparties pour la toilette de dire « bonjour », de s’enquérir d’un « comment ça va », de vérifier que l’eau n’est ni glacée ni brûlante, et vous en avez d’autres qui, dans le même temps, ont établi une relation avec la personne et ont fait attention à ce qu’elle ressentait.
« Alors que nous sommes dans la chambre de notre fils, l’interne qui le suit depuis le matin vient à notre rencontre et nous annonce sans autre forme : « C’est une tumeur. Il faut savoir maintenant si elle est maligne ou non. » L’interne quitte la chambre et je reste près de mon fils qui me dit : « Je vais mourir ? » Je suis désemparé, désarmé et je lui demande pourquoi il pose cette question. L’explication qu’il me donne c’est son interprétation de « tumeur » par « tu meurs ». » (Parents d’un enfant hospitalisé)
On en revient à la question de l’attention à l’autre. C’est en effet bien elle, ou plutôt son absence, bien plus que les horaires, les contraintes, relativement bien acceptées, supportées, qui fait la différence. La majorité des témoignages qui relatent la violence de la nuit dans certains services, la violences des néons soudain allumés, des bruits des portes, des chariots et des voix, des réveils brutaux, ne se plaignent pas du réveil, du bruit ou de la lumière : ils se plaignent de ce qu’il était visible, clair, que pas une seconde le soignant en question n’avait fait attention à ces éléments, n’avait pris soin d’en atténuer la brutalité, n’avait montré empathie ou attention. Ce n’est pas le fait de subir des désagréments, de ressentir des sensations désagréables ou des douleurs, que la majorité de ces patients vivent comme une offense et une violence. C’est le fait de voir qu’ils n’existent pas dans l’esprit de l’autre, que tout ce qu’ils vivent, souffrent, subissent, n’existe pas dans cette petite partie de l’esprit de l’autre censée lui permettre d’être sensible à ce que ressentent ses frères humains.
Oui, l’offense est là. Elle n’est pas de bruits, de douleurs, de néons, d’eau froide. Elle n’est pas faite au corps. Elle est faite au sujet. Elle le nie.
Que la « banalité » de ces maltraitances ne nous trompe donc pas : tout acte qui, lorsqu’il est pratiqué sur une personne exactement de la même manière qu’il serait pratiqué sur un mannequin ; toute conduite qui, lorsqu’elle est faite en présence d’une personne exactement de la même manière qu’elle serait faite si nul n’était là, reviennent à dire à cette personne qu’elle n’existe pas. Là est l’offense.
Quelques « droits traceurs de la maltraitance ordinaire »
L’étude consacre ensuite un chapitre à quelques « droits « traceurs » de la maltraitance ordinaire » : accès à l’information ; prise en charge de la douleur ; atteintes à l’intimité et à la confidentialité ; hygiène corporelle et traitements dégradants ; situations particulièrement à risque (réanimation ; urgences ; fin de vie).
Beaucoup de témoignages importants, dans chacun de ces domaines.
Intimité et hygiène. Révélant les humiliations (moqueries, reproches…) souvent subies lorsqu’en mangeant, en vomissant, en pissant, on se salit ou on salit ses vêtements ou ses draps…
Témoignant aussi des incontinences nosocomiales – comment appeler autrement ces incontinences fabriquées par le fait d’imposer à des personnes continentes, pendant des jours et des nuits, de « faire dans [leur] couche » ?
En réanimation, en fin de vie. Révélant à quel point les proches, qu’ils soient parents ou enfants de la personne malade, sont souvent vécus comme des problèmes, des dérangeants. Montrant ces personnes malades qui « deviennent la propriété de l’hôpital » tant elles sont englouties dans la grande machine, séparées de leurs proches et du monde. Y compris parfois à quelques heures, à quelques jours de leur mort…
« Les deux dernières semaines, ma belle fille a été considérée comme perdue et jamais nous n’avons eu l’autorisation de la voir et d’aller l’embrasser. Nous ne l’avons jamais revue du jour où elle est entrée à l’hôpital. Mon fils, médecin lui-même, en faisant le forcing a pu l’approcher quelques minutes. Est-ce humain de laisser une jeune femme seule, absolument seule, sans que personne ne puisse l’approcher, ne serait-ce que quelques minutes avant de mourir. » (Belle mère d’une personne hospitalisée)
« Traitée « d’obstacle aux soins », je me suis appliquée à respecter notamment les horaires bien qu’au fil du temps je sois partie un peu plus tard le soir. Les tout derniers temps, j’ai été autorisée à rester aussi tard que je le voudrais et même – ceci n’a pas été de soi – à venir à 6h45, heure de démarrage de l’équipe de jour, pour donner le petit déjeuner. Cela n’a dérangé personne, ni professionnels ni autres patients. Mais c’était trop tard pour ma mère qui n’en était plus là. Je vous ai demandé un jour si ma mère dormait et si les nuits se passaient bien, à quoi vous avez répondu qu’il n’y avait rien à signaler. Or une des infirmières de nuit, à la fin, m’a appris que ma mère avait toujours « appelé sa fille la nuit ». Ce point restera insupportable et ineffaçable. » (Fille d’une personne hospitalisée)
« Au fur et à mesure que le temps passe, j’arrive à prendre un peu plus de recul. Un peu. Je ne suis plus aussi blessée par les violences qu’ils ont pu commettre après la disparition de Jeanne. Je sais en revanche que je ne leur pardonnerai jamais de ne pas m’avoir laissé une place aux côtés de Jeanne. Ou plus exactement de n’avoir pas permis à Jeanne de me savoir à ses côtés. C’est plus la violence qui lui a été faite que celle que nous avons subie qui me révolte. Malgré la difficulté, nous adultes, nous pouvons mettre des mots sur nos blessures et finir par faire la part des choses. Elle, du haut de ses neuf petits mois, elle ne le pouvait pas. » (Mère d’un bébé hospitalisée)
« A côté, un petit garçon va moins bien. Sa maman est désespérée. Elle me dit qu’elle n’a jamais pu rester avec son fils. (…) Elle a accouché prématurément il y a un mois ou deux et son petit a déjà subi plusieurs interventions. Les médecins sont pessimistes et parlent d’arrêter les soins. Tous les jours elle vient. Tous les jours elle est refoulée. » (Mère d’un bébé hospitalisé)
Les professionnels se plaignent de plus en plus (et à juste titre) de l’augmentation des agressions qu’ils subissent de la part des usagers. Il faut, nous l’avons dit, distinguer : les agressions qui sont le fait de patients brutaux, irrespectueux, violents…, et les agressions qui naissent en réaction à des phénomènes comme ceux que nous venons de citer. Celles-là, les réactionnelles, il est plutôt étonnant, à lire ces témoignages, qu’il n’y en ait pas plus…
Quant à ce droit que des institutions (voir aussi cet article), des services, des professionnels s’arrogent, de séparer les personnes de leurs proches, de régner en maître sur la présence et l’absence, de contrôler la vie relationnelle des patients… Il faut continuer à se battre, tous, citoyens que nous sommes, qu’on soit professionnel ou pas, malade ou pas maintenant, pour qu’il soit possible, comme cela a heureusement lieu dans certains services, dans certaines institutions (et sans poser plus de problèmes que de bienfaits !), d’accompagner vingt-quatre heures sur vingt-quatre un proche fragile, qu’il ait 6 mois ou 95 ans, dans toutes les situations de fragilité, de peur, de soin, de vie, d’agonie, où la solitude est une souffrance.
La mort
La mort cachée, la mort taboue. Dans notre culture quotidienne les professionnels de la santé, médecins en tête, sont souvent présentés comme des blasés de la mort, à force de la côtoyer, n’est-ce pas, ils en ont vu d’autres, « la routine mon capitaine ». Foutaises. Pétés de trouille, comme tout le monde. Mais s’en cachant – tellement de connaissances, de grands mots, de techniques, d’occupations, de prétextes, pour fuir. Oui, face à la mort et au deuil, tout particulièrement, fuite, évitement, et mourants et proches qui subissent de plein fouet ces défenses.
« Mon mari est arrivé. « Elle n’est plus en haut, on va vous faire une présentation. » Pourquoi ces mots si techniques, sans chaleur. Elle ne pouvait pas nous dire : « On va vous montrer votre bébé » ? Ce n’était donc plus qu’une formalité ces retrouvailles du papa avec son bébé perdu ? Et on nous a amenés voir notre bébé dans cette pièce où on met les bébés et les autres. Avec un crucifix que j’ai retourné. Parce qu’on ne nous avait rien demandé. (…)
Fliqués, pistés toujours. Quelqu’un rentre avec nous dans la pièce. Je l’ai mis dehors. Gentiment. Mais ce n’était pas sa place. Est-ce si incompréhensible ? Et puis au bout d’un moment pas très long, la même surveillante qui attendait dans le couloir avec ses deux sbires est revenue. « Vous ne pouvez pas rester là. Il y a des lois… on va la mettre où il faut. » On va la mettre où il faut ! Vous rendez-vous compte ? Ce bébé que nous aimions par-dessus tout, dont j’étais encore et toujours débordante de lait, en la disparition duquel nous ne pouvions et ne pouvons toujours pas croire, allait partir dans son frigo !!! Et on nous le disait. On va la mettre là où il faut. J’ai explosé de colère. On n’a pas le droit de dire des choses pareilles, de dire des choses aussi brutales à des parents hébétés de douleur. Notre amour, notre princesse allait partir dans son frigo. Dans la froideur mortelle du frigo de la morgue.
Mais de quoi nous plaignions-nous ? « Vous savez, nous précise-t-elle, on a fait une exception. En principe, c’est fermé. Vous n’aviez pas le droit de la voir. (…) On a autre chose à faire à l’hôpital. » » (Parents d’un bébé hospitalisé)
Ici, après ces derniers témoignages, il nous faut nous arrêter.
Parce que tristesse, que rage.
Et qu’il serait injuste de ne rapporter que cela, de n’entendre parler que de ces endroits-ci, que de ces soignants-ci.
Il serait injuste, tout particulièrement ici, maintenant, de ne pas dire les autres. Injuste de ne pas rappeler qu’il existe des endroits où ces phénomènes n’ont pas lieu, ne peuvent pas avoir lieu grâce à celles et ceux qui y travaillent, soignants vigilants, attentifs, d’autant plus soucieux de l’autre qu’ils le voient fragile, d’autant plus chaleureux qu’ils sentent le froid, la peur, la grande vulnérabilité.
Parce qu’ici, maintenant, tristesse et rage, il serait injuste de ne pas rappeler la douceur, la complicité, la tendresse, le calme, l’écoute, dont témoignent les soignants qui n’apparaissent pas dans cette étude, soignants qui prennent soin des forces de vie, qui soutiennent, veillent, apaisent.
Le point de vue des professionnels
Le troisième chapitre de l’étude, à travers des entretiens menés avec un certain nombre de professionnels, permet d’appréhender cette « maltraitance ordinaire » de leur point de vue.
Trois aspects retiennent ici plus particulièrement l’attention :
Les points sur lesquels les professionnels dressent à peu près les mêmes constats que les usagers (notamment les atteintes à l’intimité, à la confidentialité, l’imposition des rythmes, certaines pratiques – changes imposés, etc.) et les points – qui seront donc les plus cruciaux dans une démarche d’amélioration des pratiques et de prévention de la maltraitance – sur lesquels le ressenti des professionnels est en décalage avec celui des usagers : notamment, je l’ai évoqué, la question de l’information et, au-delà, l’attention portée à tout ce qui respecte et soutient l’autonomie ( psychique ). Encore trop de soignants se situant dans une forme de « bienfaisance » un peu paternaliste qui peut tout à fait ignorer la parole de l’autre, ses attentes, ses ressentis…
L’importante sensibilité des professionnels interrogés à ce risque de banalisation qui peut conduire un service entier à adopter peu à peu, insidieusement, un fonctionnement distillant quotidiennement cette maltraitance ordinaire. Le constat également de ce mécanisme qui conduit bien souvent un service maltraitant à le rester, les nouveaux professionnels qui arrivent, soit le supportant et se mettant à fonctionner comme les autres, soit ne le supportant pas et, ne pouvant parvenir à le changer tout seul, partant assez rapidement. Constat qui dit aussi implicitement les carences d’équipes de direction qui soit supportent également ce fonctionnement banalisé, soit… n’en ont même pas connaissance.
Les éléments évoqués comme causes de la « maltraitance ordinaire ». Les professionnels interrogés parlent notamment de la confrontation à la souffrance et à la mort ; du manque de temps et de moyens ; du manque de qualification et de formation ; de l’encadrement défaillant ; de l’épuisement ; de la précarisation de certains professionnels ; de la protocolisation et de la technicisation excessives…
Selon les situations, les institutions, les services, ces éléments sont en effet, avec des influences variables de chacun d’entre eux à un moment donné, tous susceptibles de favoriser ou d’entretenir ces maltraitances.
De les favoriser… mais de les provoquer inévitablement ?
La maltraitance ordinaire comme mode de défense ?
Un mode de défense bien paradoxal. Car ce serait pour se protéger de ce corps malade, souffrant, mourant, que l’on se blinderait… Mais à lire ces témoignages, c’est à l’autre que l’on se blinde, à sa parole, à sa sensibilité, et ce faisant on le restreint justement au corps qu’il a (et non au corps qu’il est, habité, que sa parole peut nous dire), on va même jusqu’à restreindre ce corps entier à un ensemble d’organes séparés les uns des autres – créant un corps désunifié, un corps sans sens, un corps objet, un corps douleur, blessure, qui se remplit et se vide, etc. Celui-là même dont on voulait se protéger…
Paradoxe. C’est bien souvent la peur de la souffrance et de la mort qui nous conduit à chasser les pensées et les mots capables de les dire, la souffrance et la mort – et la maladie, et l’effroi, et le dégoût. Alors on les tait, on les cache, on réduit tout à de la gestion technique et administrative, croyant ainsi se débarrasser de ce qu’on ne dit pas, de ce qu’on ne pense pas. Et ça sort donc de partout, des corps eux-mêmes qui prennent justement la parole pour hurler, des épuisés, des violents, de partout. A l’image d’une société qui la cache, qui la tait, la mort, qui en finit par déguiser ses corbillards en mini-bus de touristes japonais, qui se fait croire que tout est plaisir, jeunesse, force, qui confond indépendance et autonomie, désir et possession, jeunesse et santé, qui se joue la toute-puissance et l’immortalité et qui tente chaque jour plus fébrilement de colmater les brèches qu’elle a elle-même ouvertes et par lesquelles la violence et la mort ne cessent de revenir.
Ce paradoxe, on le retrouve dans certains lieux, dans certains services ou établissements parfois : face à la douleur, à la maladie et à la mort, tout ce qu’on fait pour s’en protéger, dans la rigidité, la maniaquerie, la mécanisation, tout cela étouffe la vie, la vie avec ses incertitudes, ses souplesses, ses excès, ses bouffées de délire mais aussi de joie, ses souffrances mais ses jouissances, etc. Bref, on tue tout ce qui maintient le vivant vivant parce qu’on a peur de ce que ce vivant nous dit de sa part d’ombre, d’impermanence, de souffrance.
Partout, on tue ainsi la vie. Paradoxe – sous de petites formes (telle dame diagnostiquée « malade d’Alzheimer » dont on a peur qu’elle perde sa montre, alors même qu’elle ne l’a encore jamais perdue. On la lui enlève donc – perdue pour elle. Tel vieux monsieur qui tombe de temps en temps. Trouille. Il va finir par se péter le col et grabatisation assurée. Alors, contention. Et grabatisation). Petits paradoxes. Paradoxes « ordinaires ». Petits reflets, petites vagues de ce grand paradoxe qui nous fait tuer la vie par peur de ce qu’elle contient la mort.
Paradoxes aussi que toutes ces situations où nous nous concentrons sur le trouble du comportement avant de nous demander le sens du comportement, où nous regardons la flaque de pipi au lieu des yeux perdus de la dame, où nous veillons à l’assiette plus qu’à l’appétit, au lit bien fait plus qu’au désir de dormir… Petits paradoxes qui nous éloignent si facilement du sens, de l’échange, et nous plongent alors justement dans ce qui aiguise la peur : un monde sans sens et sans échanges.
Il nous faudra donc être particulièrement attentifs, au fur et à mesure que nous travaillerons avec cette notion de « bientraitance », à bien la développer comme une démarche de vie, et à bien défendre, contre ces rigidités et ces défenses paradoxales, qu’elle implique avant tout reconnaissance du primat de la relation, qu’elle demande souplesse et ajustement, ouverture à l’incertitude et au doute, à l’imprévu et au chaos, acceptation de tout ce que la vie contient…
Un autre mode de défense : les espèces
Ce que nous disent aussi ces témoignages de la maltraitance ordinaire, c’est ce phénomène qui nous pousse mentalement à créer des territoires, ou plus exactement des espèces. Il n’y a pas des humains fragiles et dépendants des deux côtés du soin, certains travaillant là, d’autres y vivant, certains à un moment de leur vie où ils sont plus solides, où ils peuvent donc davantage soutenir, seconder, prendre soin, d’autres à un moment de leur vie où ils ont plus besoin qu’on les soutienne, qu’on les accompagnent, qu’on en prenne soin. Non, pas de fraternité, d’humanité, de fragilité, de dépendance partagées. Deux espèces. L’espèce des proprios et celles des passants, l’espèce des puissants et celle des impuissants, l’espèce des bien-portants et celle des malades, l’espèce des sachants et celle des ignorants, l’espèce des indépendants-autonome et celle des « personnes dépendantes », l’espèce des vivants et celles des mourants.
Ce phénomène, qui parmi nous pourrait être sûr de toujours y échapper ? Ce phénomène par lequel – aidants (professionnels ou proches) de ce malade, de ce mourant – nous tentons de nous faire croire et disons ainsi au travers de bien des situations rapportées dans cette étude : que nous ne sommes pas de la même espèce. Que cette mère qui perd son petit, que cet homme blessé d’attente et de silence dans un coin de couloir, que cette femme nue devant des soignants qui papotent, que ce vieux au corps rongé, que cette vieille au dernier soupir, c’est pas nous, c’est pas des comme nous, des mêmes, des semblables. Non, non, non, nous, jamais, jamais de ce coté là. Pas de cette espèce-là.
On aurait beau doter tous les hôpitaux de France de plus même de personnel qu’il n’en faudrait pour travailler dans d’excellentes conditions, et tout agrandir, repeindre, décorer, moderniser, suréquiper, technologiser, cela ne changerait rien à cet aspect là. A cette nécessité psychique qui nous guette tous un jour ou l’autre de maintenir deux espèces.
Cela, pour peu à peu le changer, il faut plus que des choses, que du nombre. Il faut du temps. Mais pas un temps juste pour assurer encore mieux sa technique, pour encore mieux répondre aux nécessités médicales, pour remplir encore plus de tableaux. Un temps pour permettre l’élaboration, seul et à plusieurs, de la pensée, du questionnement, pour permettre que vivent les peurs, les doutes, les inquiétudes, sans qu’elles nous terrassent, pour réellement se reconnaître dépendant, vulnérable, mortel. De la même espèce. De la même famille. Fraternité et empathie.
Ce temps-là, celui de la pensée, du questionnement, celui qui conditionne l’éthique, celui qui crée cet espace relationnel qui me permet d’accueillir le souci de l’autre, d’être attentif à lui, etc., n’est pas compatible avec le travail à la chaîne, avec la taylorisation et la mécanisation des soins. Avec ce que certains veulent faire de l’hôpital.
Culture et résistance
Au-delà de la question des moyens, il s’agit bien d’une question de culture, de société. L’hôpital reflète ce qui agite la société. Et la violence de la société, dont une partie apparaît sous forme de violence physique, agit aussi du côté des soignants. Et la violence de certains discours à l’oeuvre dans notre société – discours présentant la santé comme un capital, la maladie comme une faute dans l’entretien dudit capital, le handicap ou la fragilité comme des tares, la dépendance enfin comme une caractéristique de certains vieux malades et/ou handicapés alors qu’il s’agit d’une caractéristique de l’être humain… Et la violence des discours accusant les fragiles de « coûter cher », de freiner les puissants-performants…
La violence de ces discours et de ces pensées atteint aussi l’hôpital, les soignants qui y travaillent. Parmi eux, de très nombreux résistent à cette violence, luttent contre ces discours. Mais d’autres les adoptent, d’autres relaient cette violence. La renvoient sur ces plus faibles qui dépendent d’eux.
Pas si évident, pas si facile, quand on baigne dans une culture qui accuse certaines catégories de la population de trop « dépendre », de trop « coûter », de ne pas hurler avec les loups.
Il faut résister. Évidemment. Face à ces forces de mort qui sont à l’œuvre, qui empêchent de plus en plus la pensée, la réflexion, le silence, qui tentent en permanence de recouvrir d’argent, de choses et de bruits tout ce qui est gratuit et frêle, tout ce qui se plaît à vivre pour autre besoin que dominer, asservir et posséder, tout ce qui cherche simplement à grandir en sensibilité et en autonomie en cheminant aux côtés d’autres marcheurs de la même quête…
Résister – plus facile à dire qu’à faire. Peut-être, déjà, un premier pas : se méfier de ce moment où, face aux contraintes, on risque de baisser les bras, de démissionner intérieurement. Où l’on risque d’abdiquer devant le réel. De ne plus croire que « nous sommes libres de changer le monde et d’y introduire de la nouveauté » [3].
Ce moment où le « nous n’avons pas les moyens », où le « nous ne sommes pas assez nombreux », nous conduisent à ne plus nous battre, lutter, penser. Où tout devient un « nous n’avons pas le choix », un « ça ne peut pas être autrement ». Ce moment où nous laissons ainsi ceux qui nous en privent, de ces moyens, triompher – car c’est bien eux qui triomphent à chaque fois qu’ils gagnent ainsi notre résignation. Alors, vrais vaincus, de nous-mêmes encore plus que par les autres, nous nous résignons, mettant en berne notre imagination, notre curiosité, notre souplesse… Alors, au lieu de voir comment, ce manque de moyens, le combattre, le contourner, s’unir – patients, professionnels ensemble – contre, nous risquons de nous surprendre un jour, sans un mot, sans une révolte, sans une action, à le retourner contre ces plus fragiles encore dont nous prenons soin. Nous vengeant ainsi de la conscience bien étouffée de notre démission et de notre servitude.
Nous militons, nombreux, depuis des années, et témoignons sans cesse de ce que le manque de moyens et la pénurie de soignants ont des conséquences désastreuses. Mais une fois qu’on a dit ça, on a encore à dire, on a encore à faire !
A penser. A créer [4]. Dans le prendre-soin, à lutter contre les automatismes, les habitudes, contre tout ce qui affaiblit et écrase l’autonomie, l’esprit de création, la vigilance à l’autre, tout ce qui fait oublier le vivant, le mouvant, l’incertain. A ne pas hésiter à témoigner (se taire en présence d’un délit ou d’un crime, même au nom d’une confusion entre dénonciation et délation et d’un mépris légitime pour cette dernière, est une complicité). A militer sans arrêt pour que la loi soit là, présente, identique pour tous. Et pour que le respect, la sincérité et le souci de l’autonomie de l’autre soient des valeurs défendues et appliquées à tous les niveaux des établissements de santé.
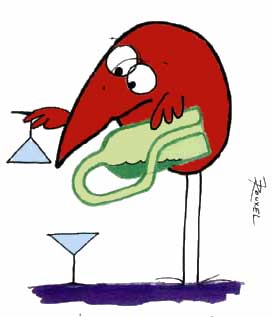
Mais ça commence à bien faire, hein, ces dessins idiots
en plein milieu de cet article très sérieux.
Disons-le une dernière fois : on ne peut séparer les questions de moyens des questions de compétence, de qualification, de culture. La culture du patient soumis existe dans des institutions ayant des moyens supérieurs à d’autres ; la démarche d’un prendre-soin centré sur la personne, avec une vigilance à son ressenti, etc., existe dans des institutions ayant des moyens… moyens.
Pour autant, le travail à la chaîne, le manque d’autonomie et de connaissances, le stress, l’épuisement, sont des facteurs qui psychiquement altèrent nos capacités d’empathie et de compréhension de l’autre. On démissionne parfois trop vite de notre humanité et de notre faculté d’empathie au prétexte du manque de moyens, mais on sous-estime aussi trop souvent ce que l’épuisement, causé entre autres par les contraintes et pénuries qui sont en train de s’aggraver dans nos établissements sanitaires et sociaux-sanitaires, provoque comme dommages sur nos facultés psychiques, relationnelles et empathiques.
« Le gynéco que j’ai vu m’a dit que j’avais un cancer. Il m’a précisé : « On peut vous guérir mais il va falloir enlever le sein. » Je n’étais pas contente. Il m’a répondu : « A l’âge que vous avez ce n’est pas un problème. » Je lui ai dit que j’aimerais bien voir sa réaction si on lui annonçait qu’on lui en enlevait une ! »
Une démarche de bientraitance
Évoquons rapidement pour finir la dernière partie de ce troisième chapitre de l’étude, où les professionnels évoquent les actions et les conditions nécessaires pour prévenir cette maltraitance et pour engager durablement une démarche de bientraitance.
Si l’on reprend la synthèse de la HAS, les principales « voies identifiées par les professionnels permettant de construire une politique de bientraitance » sont (en italiques, les autres passages étant mes commentaires…) :
« Un engagement du management de l’établissement et des services invité à poser un cadre de référence clair »
En langage plus direct, cela signifie que les soignants attendent des équipes de direction qu’elles fassent leur travail en lien avec le sens de leur mission, avec le sens du prendre-soin, qu’elles soient présentes sur le terrain et qu’elles soient vigilantes aux écarts délétères entre demandes-injonctions et moyens alloués… Ce qui reflète aussi l’attente forte d’un encadrement de proximité solide – et qui dit solide implique qu’on veille là aussi, en termes de temps et de formation, aux conditions de cette solidité.)
“Une meilleure identification des situations ;”
Ce qui signifie également de multiplier les réflexions sur ces thématiques de « maltraitance » et de « bientraitance », encore bien floues, encore peu nombreuses au regard de l’urgence.
Ce qui signifie aussi bien distinguer – enfin, autant que faire se peut – les situations de maltraitance ordinaire qui impliquent d’abord en effet une démarche de bientraitance, des situations de maltraitance « pénales » (délits et crimes) qui ne devraient pas poser plus de questions dans un hôpital qu’elles en posent au dehors. Le statut professionnel du coupable et le lieu du délit ne rendent pas soudain un délit moins délictuel ou un crime moins criminel. Même loi pour tous, même loi partout.
Ce qui signifie enfin de mener un réel travail sur la connaissance des droits. Droits des citoyens, droits des patients. Pour tout le monde, dans un premier temps : les professionnels connaissent-ils bien leurs droits ? Les patients connaissent-ils bien leurs droits ? Pour les professionnels tout particulièrement dans un second temps : car la connaissance des droits des patients est nécessaire pour des professionnels qui ont pour devoir de les respecter (comment respecterait-on des droits si on ne les connaît pas ?).
“La formation et la sensibilisation des professionnels ;”
Des formations, notamment à ce qu’est la relation de prendre-soin et la vulnérabilité ; aux spécificités du prendre-soin dans tous les domaines à risque de maltraitance ; à la fin de vie ; aux syndromes démentiels ; etc.
Des formations, comme des démarches, les professionnels interrogés le soulignent, qui doivent être suivies et partagées par tous, membres des équipes de direction et médecins compris…
Des formations, comme des démarches, qui ne pourront donner leurs fruits que si, comme c’est le cas dans cette étude, comme c’est le cas dans ce que l’ANESM comme d’autres nous disent du prendre-soin et de la bientraitance, nous inscrivons au cœur de ces réflexions la perspective des personnes fragiles, leurs attentes, leur autonomie, etc. Les meilleurs intentions de l’aidant, la plus belle bienfaisance de l’aidant, s’il est sourd à l’autre, ne garantiront jamais qu’il évitera la violence…puisque celle-ci réside justement dans la surdité.
“La réflexion sur les pratiques ; »
Mais il ne suffit pas de la souhaiter pour qu’il soit aisé de la faire. Réfléchir aux pratiques implique là aussi une volonté et des moyens pour que de vrais temps, de vrais espaces, soient consacrés à lutter contre la banalisation de cette maltraitance « ordinaire » et à améliorer les pratiques – que ce soit à travers l’apport de regards extérieurs, le travail de comités d’éthique efficients, de groupes d’analyse des pratiques pilotés par des professionnels formés à cela, etc.
(Voir également, sur le site de la HAS, les suites qu’elle entend donner à ce travail à travers le développement de différents outils et démarches)
La HAS, dans sa synthèse, oublie de rappeler un aspect clairement évoqué par les professionnels interrogés comme condition essentielle de toute démarche de bientraitance :
Un encadrement et un « management » qui soient en harmonie avec ce qu’est le prendre-soin, l’accompagnement, la mission des établissements. Qui ne traitent pas les soignants comme des machines incapables d’autonomie, etc. Qui n’exigent pas des soignants plus que ce qu’ils leur fournissent en conditions d’application de ces exigences. Qui donnent aussi l’exemple de la souplesse, de l’ajustement, du respect de l’autonomie, du partage d’informations et du dialogue, etc. Une organisation et un « management » rigides produiront toujours des pratiques rigides. Et des soignants non autonomes auront toujours du mal à veiller à l’autonomie des personnes malades…
Pour conclure…
Le rapport de la HAS est sans surprise pour celles et ceux qui combattent ces maltraitances depuis des années ou des décennies. Sa publication est néanmoins un signe fort que sont en train de tomber certains tabous, que la chape de plomb qui entourait ces phénomènes il y a quelques années s’est levée. Signe fort également que cette notion de « bientraitance », puissante dans le champ médico-social, au cœur d’une conception d’un prendre-soin sensible à la qualité de vie et au bien-être, est enfin saisie par le champ sanitaire. Il faudra veiller néanmoins à ce que ledit champ ne la rigidifie pas…
Enfin, rappelons, comme nous l’écrivions récemment au sujet de la bientraitance, qu’il faut que les moyens suivent pour que ces appels à un véritable changement de culture puissent être soutenus concrètement. Sinon, la « bientraitance » sera ressentie par nombre de professionnels comme une injonction contradictoire de plus, comme une manière de se défausser sur eux, qui sont en première ligne, de toute responsabilité socio-politique, bref, comme une instrumentalisation un rien perverse.
Et puisque la HAS, dans sa synthèse, émet le beau souhait d’« une évolution plus générale, soutenue par le reste de la société, vers une culture de la bientraitance », il est important de finir sur cette inquiétude, ce souci, en effet plus général, évoqué récemment par Jean-Paul Delevoye, le Médiateur de la République :
« Je déplore enfin, en ce problème de la maltraitance, une nouvelle illustration de l’attitude étrange et terriblement inquiétante que développent nos sociétés envers les plus vulnérables. Cette forme de sadisme n’est pas sans rappeler les actes odieux de violence envers les SDF, médiatisés il y a quelques mois, et rappelle la nécessité de renforcer les mécanismes de protection envers les personnes les plus fragiles. Notre société gère son angoisse par une décharge d’agressivité au lieu de développer un regain de solidarité. »
Juliette Pellissier – Article publié en 2009.
[1] Sur ce « proche perturbateur » et sur les autres habitants de la planète « maison de retraite » et de la planète « hôpital », ce si juste texte de Marguerite Mérette intitulé Sur une autre planète :
[2] Dialogue extrait d’un livre de P. L. que je préfère ne pas citer ici pour éviter certains malentendus.
[3] Hannah Arendt poursuit : » Sans cette liberté mentale […] de dire « oui » ou « non » – en exprimant notre approbation ou notre désaccord […] aux réalités telles qu’elles nous sont données, […] – il n’y aurait aucune possibilité d’action. »
[4] « Résister, c’est créer » : on trouve cette expression dans le superbe « Appel des résistants aux jeunes générations »
