Le livre important de Peter Whitehouse, Le mythe de la maladie d’Alzheimer, vient de paraître en français. Analyse…
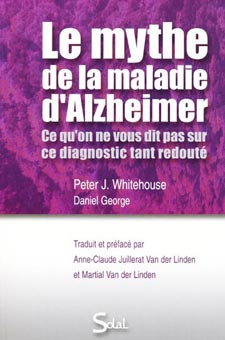
« On peut se demander si la sénilité est une conséquence de la sénescence, si elle ne serait pas plutôt un produit artificiel de la société qui rejette les vieillards. […]
On est même fondé à se demander si le vieux concept de démence sénile, résultat prétendu de troubles cérébraux, n’est pas à réviser complètement – et si ces pseudo-démences ne sont pas le résultat de facteurs psychosociologiques, aggravés rapidement par [des environnements] où ces malades sont livrés à eux-mêmes, privés des stimulants psychologiques nécessaires, sevrés de tout intérêt vital et n’ont plus qu’à attendre une fin qu’on s’accorde à souhaiter rapide. Nous irons même jusqu’à prétendre que le tableau clinique des démences séniles est peut-être un artefact, dû le plus souvent à la carence des soins et des efforts de prévention et de réhabilitation. » [1]
Cet extrait d’un ouvrage que Roger Bastide écrivit en 1965 – Sociologie des maladies mentales –, cité en 1970 dans La vieillesse de Simone de Beauvoir, témoigne de ce que le souci de faire la part des choses entre une éventuelle maladie et les aspects psychosociologiques pouvant contribuer à en produire les symptômes, n’est pas récent. Un souci qui n’a d’ailleurs pas cessé d’habiter les œuvres de plusieurs auteurs français – Louis Ploton et Jean Maisondieu étant sans doute les plus célèbres d’entre eux (le lecteur intéressé trouvera davantage de références sur ce sujet dans le chapitre de La nuit tous les vieux sont gris qui lui est consacré).
Ce petit rappel pour que la lecture du livre de Peter Whitehouse ne nous fasse pas oublier que certaines des idées qu’il défend ne paraissent aujourd’hui révolutionnaires que parce qu’elles ont été précédées de quarante années de domination d’une vision hyper-biologisante, hyper-neurologisante et hyper-réductionniste des syndromes démentiels. Quarante années où les voix des auteurs que nous évoquions à l’instant ont bien souvent eu du mal à se faire entendre tant la gériatrie et, en partie, la gérontologie, étaient envahies par le credo du « la démence se réduit à des lésions neurologiques lesquelles produisent mécaniquement des symptômes lesquels détruisent indistinctement et inéluctablement les personnes ».
Il faut en revanche indiquer que l’une des originalités du livre de P. Whitehouse est d’être écrit par un neurologue, qui plus est par l’un des plus célèbres neurologues américains de ces dernières années ; et souligner que ce livre n’est que le grand témoin d’un phénomène tant attendu : de plus en plus de neurologues osent exprimer leurs doutes et leurs incertitudes quant à la vision dominante de la maladie d’Alzheimer.
Mais revenons à P. Whitehouse : le regard qu’il porte sur l’entité « maladie d’Alzheimer » est celui d’un scientifique l’ayant beaucoup étudiée. Le regard qu’il porte sur les examens, le diagnostic, l’accompagnement du diagnostic, est celui d’un clinicien qui n’hésite pas à reconnaître aujourd’hui à quel point il fut incapable longtemps de réellement accompagner ses patients.
Avouons-le : les passages de l’ouvrage consacrés aux aspects neurologiques sont un peu frustrants. Tout ce que pointe P. Whitehouse – importance des différences individuelles dans les types de symptômes et dans l’évolution de la maladie ; liens bien lâches entre lésions et symptômes [2] ; fragilité des preuves d’une forme « pure » de « maladie d’Alzheimer » et importance des facteurs vasculaires ; fragilité également des frontières entre les différentes formes de démence ; importance du facteur volume cérébral, etc. –, qui témoigne notamment de qu’on ne peut avec certitude et rigueur distinguer nettement un vieillissement « normal » d’un vieillissement « avec une maladie d’Alzheimer », mériterait d’être davantage précisé et accompagné d’études et références plus nombreuses.
D’autant que ces études et références existent – et il est probable qu’on doit leur absence dans l’ouvrage à cette triste habitude qui pousse désormais certains éditeurs (ici américain, l’honneur gaulois est sauf [3]), à censurer toute note de bas de page, toute référence, dès lors que l’ouvrage vise le « grand public ». Il existe pourtant des manières de procéder (encadrés, annexes…) offrant au lecteur qui souhaite ne pas se plonger dans des données ou synthèses d’études les moyens de le faire aisément. Mais passons…
Bref, lecture frustrante pour qui voudrait creuser un peu plus les aspects neurologiques. Mais lecture salutaire pour qui s’intéresse à la manière dont l’entité « maladie d’Alzheimer » a été socialement et culturellement construite. Et lecture salutaire grâce à la manière dont l’auteur synthétise clairement les visions dominantes, délétères, de la maladie et des personnes malades – ces descriptions scientifico-militaires où la maladie, telle une sorte d’ennemie toute-puissante, laminerait sur son passage les individus, faisant disparaître toute question de prendre-soin, d’accompagnement, de vie-avec, ennemie ne pouvant être combattue que par la seule recherche d’une molécule miracle censée soudain permettre aux populations réjouies (acclamant leur libérateur chimique) de posséder à quatre-vingt dix ans un cerveau de trentenaire !
Maladie ou vieillissement problématique ?
Plutôt que de rester sur cette conception très rigide d’une « maladie spécifique », P. Whitehouse propose, comme le résument les traducteurs du livre – Martial Van der Linden, responsable des unités de psychopathologie et de neuropsychologie clinique aux Universités de Genève et de Liège, et Anne-Claude Juillerat Van der Linden, chargée de cours à l’Université de Genève et neuropsychologue à la Consultation de la mémoire des Hôpitaux universitaires de Genève – de « réintégrer [s]es diverses manifestations dans le contexte plus large du vieillissement cérébral, dans ses multiples expressions plus ou moins problématiques, sous l’influence de nombreux facteurs (environnementaux, psychologiques, biologiques, médicaux, sociaux et culturels) intervenant tout au long de la vie ».
Pour le dire autrement, plutôt qu’une pure et unique maladie, un « vieillissement cérébral humain d’évolution variable ». Il en serait, en simplifiant à l’extrême, du vieillissement du cerveau comme de celui des articulations, des troubles cognitifs comme de l’arthrose… De plus en plus de personnes concernées au fur et à mesure qu’elles vieillissent (mais pouvant en concerner certaines dès cinquante ans et à peine d’autres à quatre-vingt dix) [4]. Des personnes touchées très différemment, et des personnes vivant très différemment les mêmes altérations. Aux conséquences pouvant aller d’une simple gène à des situations de handicap très fortes. Et, tant pour les altérations que pour les handicaps, des influences multiples de facteurs génétiques, sociaux, psychologiques, environnementaux, économiques, culturels, etc.
La reconnaissance de ce « vieillissement cérébral humain » invariablement accompagné de troubles cognitifs conduit P. Whitehouse à affirmer : « D’une certaine manière, nous finirions tous par avoir la maladie d’Alzheimer si nous vivions assez longtemps » [5]. Une affirmation qui troublera, voire choquera, la majorité des lecteurs de l’ouvrage. Moi compris. D’où l’intérêt, j’y reviendrai, de s’interroger sur ce trouble.
Il me semble que les arguments avancés dans le livre de P. Whitehouse ne permettent pas, d’un point de vue scientifique, de trancher rigoureusement la question de l’existence ou non de l’entité nosologique « maladie d’Alzheimer » (elle n’avait d’ailleurs pas été scientifiquement tranchée à l’époque d’Aloïs Alzheimer). Il me semble également que le principal intérêt de l’ouvrage ne se réduit absolument pas à cette question – qu’on la ferme ou qu’on la laisse ouverte – mais à la richesse des constats et des questionnements qu’il permet de faire et de lancer.
Questionnements
Évoquons-en, très synthétiquement, et un peu en vrac, quelques uns (en précisant que certains sont explicitement posés par P. Whitehouse, d’autres simplement nés au fil de la lecture – autrement dit, P. Whitehouse n’est pas responsable de ce à quoi il m’a fait penser… !).
- N’est-ce pas la vision hyper-biologisante de la maladie qui conduit à consacrer énormément d’énergie et de ressources aux aspects neurologiques et pharmacologiques – bien qu’ils n’aient pas fait avancer grand chose depuis des décennies – et bien peu, en comparaison, sur l’aide, le prendre-soin, l’accompagnement ? Combien de personnes diagnostiquées avec de belles IRM dans leur dossier mais sans suffisamment d’aides au quotidien pour ne pas devenir grabataires et incontinentes… ?
- Penser la maladie d’Alzheimer comme une entité qui n’aurait rien à voir avec le vieillissement cérébral, les modes de vie, la vie relationnelle et sociale, etc. : comment cela permettrait-il de travailler, à l’échelle individuelle comme sociale, sur les facteurs susceptibles, autant que faire se peut, de veiller, tout au long de la vie, à nos facultés cognitives ?
Autour du diagnostic…
- Pourquoi le diagnostic – si souvent cause d’effroi, voire de terreur – est-il posé encore si régulièrement de manière brutale, avec certitude (alors même qu’il n’est toujours que « probable »), en laissant si peu de place au(x) doute(s) ?
- Pourquoi si souvent tant insister, dès le diagnostic, sur ce que risque de vivre la personne des années après, sur tout ce qu’elle ne pourra plus faire dans dix ans, et si peu parler de tout ce qu’elle peut encore faire, de tout ce qu’il lui reste à vivre, de tout ce qui peut lui permettre de donner du sens, de profiter de ce que la maladie n’altère pas, etc. ?
- Un diagnostic qui promet, assure, certifie, un déclin inévitable et irrémédiable peut-il provoquer autre chose dans l’esprit d’une personne cognitivement fragile et socialement fragile qu’un déclin irrémédiable ?
- Un diagnostic qui promet, assure, certifie, un déclin inévitable et irrémédiable peut-il provoquer autre chose dans les regards des autres que l’attente des signes et des symptômes de ce déclin ? Où la personne ainsi étiquetée et stigmatisée trouvera-t-elle la force psychique pour ne pas se conformer à ce qu’on dit d’elle, à ce qu’on attend d’elle ?
- Beaucoup de professionnels insistent sur ce que le diagnostic de « maladie d’Alzheimer » permet de mettre en place, d’organiser, de prescrire, comme traitements, comme aides, etc.
- Mais est-on réellement sûrs que tout cela suffit à compenser en bien tout ce que blesse actuellement ce diagnostic (tel qu’il est généralement présenté), toutes les terreurs qu’il provoque, toute cette évacuation de la personne, de la personne psychiquement autonome, de la personne désirante, pensante, etc., qu’il favorise ?
- Est-on réellement sûrs que la présentation usuelle – facteur de défaitisme et d’effroi – de la maladie et du devenir de la personne malade permet de favoriser autre chose, psychologiquement, que la dépression et le déni ? La question que pose P. Whitehouse est essentielle : en quoi un diagnostic de « vieillissement problématique » ou d’altérations cognitives, progressives mêmes, beaucoup moins effrayant, beaucoup moins destructeur, empêcherait-il de mettre en place un accompagnement et un prendre-soin pertinents ?
Une vision uniformisante
- La domination de la conception hyper-neurologique de la maladie d’Alzheimer nourrit une vision uniformisante des phénomènes en jeu et dépersonnalisante des personnes « malades ». Et pourtant, tant de récits, si différents, d’histoires individuelles, de manières dont « la maladie » est vécue, d’expériences avec la maladie. Autant de récits possibles que de personnes « malades ».
Et si tout cela nous parlait aussi d’une médecine et d’une société qui uniformisent les malades et les vieux car elle ne peut entendre leurs récits. Pas le temps pour ça ! Sûr, quand on a pas le temps, il vaut mieux vingt « Alzheimer » – vingt cerveaux lésés – vingt corps à soigner pareil, avec les mêmes médicaments, dans les mêmes structures, aux mêmes horaires, etc. Vingt errants qu’il faut surtout cadrer, surveiller, sécuriser. Un bon QHS – oh pardon, une bonne UHR (Unité d’Hébergement Renforcée) –, et c’est réglé. Manquerait plus qu’on les écoute, chacun d’entre eux. C’est où l’écoute, dans la T2A ? Et puis, s’il fallait les écouter, mais on ne serait pas neurologues, on serait psy ! J’en frémis.
Bref, et s’il fallait bien un gros-quelque-chose-bien-solide (et quoi de mieux qu’une maladie sci-en-ti-fi-que-ment établie) pour uniformiser tous ces vieux qu’on traite uniformément, pour justifier qu’on les traite uniformément ?
- Pourquoi tant d’institutions focalisées sur les aspects sanitaires et hygiénistes et si peu encore centrées sur les activités, les plaisirs, l’utilité, les relations avec les autres, etc., alors que ce sont ces éléments-là, on le constate quotidiennement, qui permettent aux personnes ayant des troubles cognitifs de trouver malgré eux, avec eux, des grands moments de bien-être, riches d’échanges et d’émotions ?
Pourquoi tant de temps et de travaux et d’argent sur les (à peine efficaces le plus souvent) réponses médicamenteuses ou sécuritaires à des problèmes (dépression, agitation, errance, etc.) en grande partie nés justement de ce que ces réponses-là sont les seules… et que très peu de moyens sont en comparaison consacrés aux thérapies relationnelles, aux différentes formes d’art-thérapie, aux aspects « milieu de vie », à toutes les formes d’accompagnement psycho-social, etc. ?
Aux bons soins d’Alzheimer…
- Ne serait-ce pas, à l’échelle d’une société, bien arrangeant qu’une telle maladie, qui nous permet de ne pas nous interroger sur la place et le rôle, familiaux, sociaux, culturels, des vieilles personnes ? Au fait, toutes ces vieilles personnes socialement isolées et économiquement hyper-fragiles diagnostiquées « démentes », si elles ne l’étaient pas, si elles étaient en pleine forme mentale, que notre société leur proposerait-elle en dehors de la télévision le jour et de la télévision la nuit ?
- Ne serait-ce pas, à l’échelle d’une société comme la nôtre, bien arrangeant que de se concentrer sur les liens entre gènes, neurones, plaques séniles, etc., plutôt que sur les relations entre la « démence » et l’alimentation, les neurotoxines, les activités – y compris professionnelles – cognitivement appauvrissantes, les interactions sociales, les ressources économiques, etc. ? Il ne manquerait plus qu’on laisse des scientifiques prouver que Simone de Beauvoir avait raison et que les citoyens socio-économiquement fragiles sont la proie privilégiée – et très paisiblement sacrifiée par l’idéologie dominante – d’un vieillissement cognitif accéléré !
- Comment lutter contre cette vision adulto-centriste et cognitivo-centriste qui fait dépeindre la démence comme conduisant à la perte de tout (de la personne, de son identité, de son unicité, de sa dignité…) et les personnes malades (celles que les professionnels appellent souvent « les déments ») comme de véritables morts-vivants ? Comment lutter contre la confusion entre déclin de certaines fonctions mentales et déclin de l’être ? Bref, comment sortir du double paradigme de la « démence » comme « perte de l’esprit » (« dé-mens », étymologiquement : « sans esprit ») et de l’esprit comme machine bio-cognitive ?
Socialement…
- Si la conception dominante de la « maladie d’Alzheimer » est en partie due à une conception de l’être humain centrée sur l’adulte-d’âge-moyen-cognitivement-performant, elle est aussi entretenue par ce que P. Whitehouse nomme l’Empire Alzheimer. Un Empire qu’il connaît d’autant mieux qu’il en fut pendant longtemps l’un des généraux, empire dominé par l’industrie pharmaceutique et celles et ceux qui défendent ses intérêts. Un Empire, précisons-le, qui n’est pas que financier – il reflète également la puissance sociale (politique, médiatique…) dont disposent certaines professions (neurologues, par exemple) et dont d’autres (animateurs, psychologues, par exemple) ne disposent pas…
- Si toutes les personnes qui vieillissent jusqu’à un certain âge subissent des altérations cognitives, si toutes les vieilles personnes sont cognitivement fragiles (rappel : mais pas toutes au même âge), la question est bien aussi celle, sociale et familiale, de la vulnérabilité, de la manière dont l’entourage, l’environnement, se conduit face à cette fragilité : car c’est bien là, dans ce lien entre l’environnement et la personne, que se situe la vulnérabilité (on peut être très fragile et peu vulnérable dans un environnement qui prend bien soin, comme on peut être peu fragile et très vulnérable dans un environnement hostile ou incompétent). Au quotidien de nos réunions de famille, on le constate banalement : une vieille dame cognitivement fragile ayant du mal à suivre deux conversations en même temps à table sera peu vulnérable si ses proches sont attentifs à cette difficulté d’attention et la compensent, très vulnérable (et rapidement isolée) si personne n’en tient compte.
- Le modèle dominant de cette maladie favorise le défaitisme thérapeutique (il n’y a rien à faire puisqu’on ne peut pas guérir). Comment, avec cette vision catastrophiste, déficitaire et défaitiste, travailler à construire cette société « troubles cognitifs inclus » dont parlent les traducteurs de l’ouvrage ? Comment soutenir aisément les travaux centrés sur la compensation des difficultés, sur l’adaptation de l’environnement, sur les ressources et désirs, sur les facteurs de bien-être… ?
- Un tel modèle n’est-il pas responsable justement de la rareté des démarches centrées sur tout ce qui peut soutenir la citoyenneté, les liens sociaux, la participation, la déstigmatisation. Il justifie en revanche, dans beaucoup de lieux, la vision terrorisante (et en partie mensongère) de la maladie telle qu’elle éclatait par exemple dans cette publicité de France Alzheimer heureusement abandonnée après quelques jours de diffusion (suite à la pression d’un certain nombre de personnes malades et de proches de personnes malades – dont on peut se demander d’ailleurs si elles avaient été consultées avant…).
Vieillir jeune !
- Et si le « mythe de la maladie d’Alzheimer » était aussi, était surtout, le mythe d’une vieillesse sans aucun trouble ? L’illusion que si la maladie d’Alzheimer nous épargnait, nous serions alors cognitivement identiques à 95 ans et à 40 ans. Aussi performants. Peut-être est-ce bien cette illusion-là, ce fantasme-là, que l’existence de la « maladie d’Alzheimer » nous permet de maintenir. Et peut-être est-ce bien parce que ce mythe-là en prend un coup que l’on est troublé, choqué, quand P. Whitehouse nous affirme que « d’une certaine manière, nous finirions tous par avoir la maladie d’Alzheimer si nous vivions assez longtemps »…
Une illusion qu’on ne peut accepter de détruire que si nous sommes prêts, socialement et individuellement, à accepter qu’il est possible de vivre en subissant des pertes, que tout vieillissement, que tout déclin de certaines facultés, ne veut pas dire que nous sommes condamnés à n’être plus, à perdre notre place, notre dignité, etc.
Il faut désormais aller lire les écrivains d’autrefois, d’avant la « maladie d’Alzheimer », pour entendre des témoins nous parler de leur vieillesse, de la manière dont ils la vivent, avec les pertes et les blessures dont elle s’accompagne. Sommes-nous, aujourd’hui, encore capable de cela : d’une vraie expérience de la vieillesse, d’une expérience d’un grandir-vieillir malgré, avec, les altérations de certaines facultés – ou demanderons-nous tous bientôt à être euthanasiés aux premiers tests de mémoire déclinants, aux premières atteintes cognitives ?
- Et s’il en était de la vieillesse comme de la maladie dont parle Jean-Paul Sartre : « La maladie est une condition de vie à l’intérieur de laquelle l’homme est à nouveau libre et responsable » [6] ? Pour autant que l’on ne confonde pas l’individu avec sa maladie, ne lui laissant alors guère de possibilité de distinguer ce qu’il est de ce qu’il a…
- On a tant insisté – et moi le premier – pour bien distinguer la vieillesse des maladies type Alzheimer. Par réaction, légitime, contre ceux qui médicalisaient la vieillesse. Mais qu’observe-t-on désormais : d’abord que cette distinction a peut-être joué un rôle dans la manière dont sont exclus les « malades d’Alzheimer », perçus comme des « vraiment pas normaux », des « vraiment pas comme les autres ». D’autre part que la vieillesse, loin d’être démédicalisée, est « alzheimeirisée » : au moindre souci de mémoire, au moindre trouble cognitif, le diagnostic est pensé – quand il n’est pas posé. Et voilà vite toute vieille personne déprimée, angoissée, inquiète, révoltée, fatiguée, etc., bref, toute vieille personne pas aussi performante et béate qu’on est censé l’être à quarante ans, étiquetée « Alzheimer », regardée et traitée comme telle.
Quel sens ?
- Indépendamment même de la question de la réalité de cette entité nosologique, on peut, comme le fait P. Whitehouse, se poser la question du sens, du sens que l’on attribue à la « maladie » ou aux troubles, de l’histoire qu’on (se) raconte à son propos, de ce qu’on dit de soi malade…
Mais comment ne serait-il pas très difficile, avec une « maladie » présentée le plus souvent comme détruisant la personne, de rester le sujet de son histoire, de n’être pas confondu avec sa maladie ? De simplement même rester sujet – de ne pas devenir l’objet des aides et des aidants, des soins et des soignants ?
- C’est bien cette histoire que l’on (se) raconte et que l’on fait, le sens qu’on attribue à ce qui (nous) arrive, qui change tout. Quel savoir sur la maladie les professionnels donnent-ils aux patients ? Pourquoi, pour un livre où ce sont des récits de patients, de familles, qui racontent leur maladie et leur vie avec, trouve-t-on trente livres avec l’échelle de Reisberg et la description de ses stades censés être psychiquement et temporellement identiques pour tous ?
(Et surtout ne suggérons pas que si tout son entourage et toute la société placardait sur un adolescent en crise d’adolescence une échelle comme celle de Reisberg, il est probable qu’un adolescent sur deux au minimum finirait totalement « dément ».)
La richesse de ces questionnements justifie donc amplement la lecture de cet ouvrage, qui détaille ce que de nombreux professionnels constatent : le diagnostic de « maladie d’Alzheimer », tel qu’il est très régulièrement annoncé et présenté, est scientifiquement fragile ; psychologiquement souvent destructeur ; et socialement fort susceptible d’arranger une société qui ne sait plus inclure ses vieux et ne peut plus penser la vieillesse et la mort.
Socialement et économiquement…
Soulignons avant de conclure que P. Whitehouse nous paraît en revanche, sur certains points, bien rapide ou bien optimiste… :
- A l’entendre, tout d’abord, changer notre regard sur les « démences » suffirait à « supprimer les stigmates du vieillissement ». On peut au contraire craindre que si certains tireraient profit de cette démédicalisation des troubles cognitifs, d’autres au contraire verraient dans le lien entre vieillissement et troubles cognitifs des raisons supplémentaires de craindre la vieillesse et de haïr leur propre vieillissement.
En proposant de « dépathologiser » la démence, P. Whitehouse prend le risque de re-décliniser le vieillissement, le risque que l’on reste dans cette ambiance militaire qu’il décrit si bien mais que l’ennemi à combattre ne soit plus la « maladie d’Alzheimer » mais la vieillesse. L’envahissante cosmétique anti-âge, la médecine anti-âge, etc., ont du reste commencé cette guerre-là.
Autrement dit, si la vieillesse s’accompagne inéluctablement de troubles cognitifs, dans une société qui ne considère ces troubles que comme des symptômes, c’est la vieillesse qui risque de nouveau et encore plus fortement qu’avant d’être perçue comme une maladie.
- P. Whitehouse exprime à plusieurs reprises sa conviction que les baby-boomers vont très fortement modifier nos manières de concevoir le vieillissement et la vieillesse. Passons sur le fait que « les baby-boomers » ne signifie pas grand chose (autant de « baby-boomers » pensant et vivant différemment que de personnes atteintes de troubles cognitifs pensant et vivant différemment). Je ne sais pas ce qu’il en est « des baby-boomers » aux États-Unis. Mais en France, de nombreux signes témoignent de ce que beaucoup de personnes de cette génération-là ne semblent pas spécialement s’illustrer par une moindre peur du vieillissement, de la vieillesse et de la mort – qu’elles sont peut-être même, au contraire, plus promptes que d’autres à mélanger autonomie et performance, et à confondre perte de performance et perte de dignité.
- La thèse défendue par l’auteur n’ira pas, dans un certain nombre de pays européens du moins, sans faire naître de nombreuses peurs sur les aspects socio-économiques. Pour beaucoup d’entre nous, en effet, la reconnaissance de la « maladie d’Alzheimer » est l’un des principaux leviers ayant permis d’obtenir peu à peu des moyens (qui restent, rappelons-le, très largement insuffisants) pour améliorer leur « prise en charge », leur accompagnement, les institutions les accueillant, etc.
Quand on voit justement l’insuffisance des moyens pour ces personnes diagnostiquées « malades d’Alzheimer », on craint même d’imaginer le « moins que rien » qu’il y aurait si ces personnes malades étaient juste dites « séniles » ou « gâteuses » (c’est bien malheureusement de telles étiquettes qui risqueraient de remplacer l’autre)…
Et en même temps…
En même temps, quand justement on voit comment la majorité des EHPAD, par exemple, qui devraient être « spécialisées Alzheimer » (j’entends par là disposant de professionnels nombreux et formés, dans des locaux adaptés, centrées sur les activités, le maintien des liens sociaux et relationnels, le bien-être, etc.) ne le sont pas, on peut se poser aussi la question : est-ce que finalement le fait de les considérer « malades d’Alzheimer » apporte tellement plus que de les considérer seulement en besoin d’aide et de soutien à cause d’un « vieillissement problématique » ? Pas sûr [7].
Il n’en reste pas moins qu’en ces temps de destruction de la Sécurité sociale, nombreux sont ceux qui, si les troubles cognitifs étaient considérés comme des phénomènes habituels de vieillissement, en profiteraient pour en conclure qu’il serait donc absolument anormal que les besoins d’aide ou d’accompagnement qu’ils impliqueraient soient pris en charge par la solidarité nationale.
(Et en même temps… Ne nous aveuglons pas : les projets actuels autour de la « dépendance » indiquent nettement que les besoins d’aide et d’hébergement des personnes de plus de 60 ans en situation de handicap (handicaps dus à des accidents ou à des « démences ») seront de plus en plus financés par les personnes et leur famille et de moins en moins par la solidarité nationale.)
Sens et responsabilité
- P. Whitehouse l’évoque rapidement : certaines personnes, confrontées à des troubles et difficultés, peuvent comprendre la notion de « vieillissement problématique », de déficits cognitifs, etc., d’autres ont en quelque sorte besoin d’une « maladie avec un beau nom bien scientifique ».
La faute n’en est pas qu’aux laboratoires qui en effet inventent régulièrement de nouvelles maladies pour augmenter les prescriptions… La faute nous est commune, à nous tous qui sommes susceptibles, toujours, de tenter d’échapper aux doutes, aux incertitudes, au hasard, aux questionnements, à notre humaine condition, par un « elle est déprimée » ou un « il est dément » – censé tout expliquer et n’expliquant rien, hormis notre fuite.
Le but est bien que chacun puisse donner du sens à ce qu’il vit : pour cela, parmi nous, certains y parviendront si le diagnostic n’est pas celui d’un « déclin irrémédiable » si pauvre en sens, si paralysant. D’autres seront rassurés par ce sens si réducteur de « lésions neurologiques qui mécaniquement… ». Reste donc la question, sur laquelle P. Whitehouse ne s’attarde malheureusement pas, de comprendre quels sont les mécanismes familiaux, culturels et sociaux qui conduisent tant de gens à souhaiter que le sens soit celui d’un « tout m’échappe », du « je ne suis plus que ce déclin que l’on me prédit », du « mon esprit est réductible à mon cerveau et mon neurologue y lit mon avenir »…
Autrement dit, pourquoi sommes-nous si nombreux, malgré les angoisses que cela provoque, à accueillir si facilement cette vision des choses qui peut tout inscrire – tout ce que dit la personne malade comme tout ce qu’elle fait – dans l’absence de sens, ou plutôt dans le sens archi-réducteur du « c’est causé par les lésions neurologiques » ?
Reste également tout cet art du prendre-soin pour trouver le meilleur équilibre entre deux extrêmes délétères, entre le « Je ne te vois plus, tu n’es que symptômes » et le « Tu es responsable de ce qui arrive, je ne vois pas qu’il y a des symptômes »…
P. Whitehouse insiste donc à juste titre sur ces questions de sens et de responsabilité.
En lien d’une part avec la prévention : il existe des facteurs de « bien vieillir cognitif » (l’expression est horripilante mais permet néanmoins de synthétiser une réalité : nos modes de vie, nos activités, notre alimentation, etc., ont bien entendu une influence sur le vieillissement cérébral). Sont-ils suffisamment connus ?
Mais peuvent-ils l’être ? Dire aujourd’hui que si l’on passe ses journées affalé dans un canapé, sans bouger, à regarder la télé en mangeant gras-sucré-salé, ça va favoriser tout un tas de pathologies, c’est admis, mais dire que si l’on passe ses journées, même en faisant du vélo d’appartement et en bouffant bio, à regarder TF1, ça ne va pas favoriser une très bonne santé intellectuelle, là on passe pour un facho élitiste. Dommage : il faudra peut-être attendre pour travailler sur ces aspects qu’un futur directeur de TF1 affirme que le « temps de cerveau humain disponible » qu’il vend à Coca-Cola profite aussi largement à la dégénérescence des neurones…
En lien également avec la part de responsabilité que, connaissant ces possibilités de prévention et d’action, chacun d’entre nous peut garder, y compris dans le sens qu’il donne aux troubles, difficultés, qu’il vit.
Si cette part de responsabilité individuelle existe (cf. Sartre), il me semble en revanche plus qu’excessif de la présenter comme a tendance à le faire P. Whitehouse sous la forme d’un « C’est entièrement à vous qu’il incombe de choisir l’histoire que vous allez vivre… », d’une sorte de « bien vieillir, c’est vous qui décidez ! ». Certes, on peut rester le sujet de son histoire, y compris quand rien autour de nous, socialement, culturellement, économiquement, ne nous aide ou soutient, mais responsabiliser ainsi les individus (très à la mode en Occident, cette responsabilisation des individus à « gérer leur capital santé » en même temps que les conditions environnementales, sociales et économiques propices à une bonne santé déclinent) sans pointer les forces immenses contre lesquelles ils se battent et contre lesquelles ils ne peuvent bien souvent pas gagner, est souvent délétère.
P. Whitehouse ne l’ignore heureusement pas tout le temps. Et, citant l’expression « Il faut tout un village pour élever un enfant », il reconnaît qu’il faut aussi tout un village pour accompagner une personne cognitivement fragile – que cette fragilité soit due à une maladie ou à la vieillesse… Post Scriptum :Les traducteurs de l’ouvrage de P. Whitehouse, Martial Van der Linden et Anne-Claude Juillerat Van der Linden, ont récemment écrit une réponse à une critique parue sur le livre dans le numéro de mars 2010 de la revue Psychologie & NeuroPsychiatrie du Vieillissement. Le lecteur intéressé la trouvera ci-dessous en format pdf.
Juliette Pellissier – Article paru en 2010.
Ci-dessous, le pdf de l’article évoqué ci-dessus :
[1] Pour éviter tout malentendu, précisons : il s’agit là d’un artefact au sens culturel et idéologique. Personne ne nie les troubles et les altérations, les changements psychologiques, les lésions neurologiques. Seulement, il n’est pas scientifiquement rigoureux et prouvé de prétendre que les uns sont causés par les autres – ou réciproquement ! –, ou que les uns sont uniquement dus à une « pure maladie neurologique bien discriminée »…
[2] De nombreuses personnes que rien ne permet de diagnostiquer cliniquement comme atteintes de maladie d’Alzheimer ont des atteintes neurologiques qui les feraient diagnostiquer comme telles… si elles en montraient cliniquement les symptômes. A l’inverse, des personnes ayant peu de signes neuropathologiques peuvent subir des troubles cognitifs très importants…
[3] C’est ironique : voilà des années que plusieurs éditeurs français commettent les mêmes inepties au nom de la « vulgarisation ».
[4] Des études, il y a quelques années, semblaient montrer qu’au-delà d’un certain âge, la prévalence des démences diminuaient. D’après P. Whitehouse, elle augmente au contraire de manière exponentielle… Je suis preneur de références récentes sur cette question !
[5] Autrement dit, le devenir normal pour qui ne meurt pas avant serait de finir usé. Physiquement usé, cognitivement usé (ce qui ne veut pas dire émotionnellement, psychologiquement, spirituellement et relationnellement usé).
Simone de Beauvoir évoque, dans La Vieillesse, les indiens Navajo pour qui l’une des plus belles morts est celle du vieux qui meurt ainsi usé, en état de sénilité, sans pouvoir rien faire sans l’aide d’autrui : cela signifie qu’il a, nous dit-elle, « épuisé sa vie », qu’il peut partir sans aucun regret.
Nous sommes à l’opposé, dans des fantasmes de mort en héros, en héros de l’âgisme triomphant, autrement dit en héros jeune, de mort en forme dès l’instant même de la crainte de faire vieux, de dépendre d’un proche, de ne plus avoir tous ses membres et toutes ses agilités mentales en parfait état de performance.
[6] Jean-Paul Sartre, Cahiers pour une morale. Paris : Gallimard, 1983. Cité par Charlotte Mémin, Comprendre la personne âgée. Paris : Bayard, 2001.
[7] Probable en revanche que parler de « plan Alzheimer » fasse bien plus sérieux que parler d’un « plan vieillesse » ou d’un « plan fragilité cognitive », comme « soigner » fait encore beaucoup plus sérieux dans certains milieux que « prendre soin ».
